
Ce document a pour objectif de rétablir quelques vérités sur l’agriculture biologique en tenant compte des dernières données scientifiques, largement ignorées par ceux qui contestent l’intérêt de ce mode de production pour la santé et pour l’environnement.
L’agriculture biologique ralentit sa croissance. Après des années de croissance à deux chiffres, la demande a brusquement diminué en 2022, avec une baisse moyenne d’environ 10 %, mettant en grandes difficultés de nombreux producteurs, transformateurs et distributeurs. Pourquoi ce brutal retournement de tendance ?
De nombreuses causes sont invoquées : l’inflation, avec comme conséquence la baisse du pouvoir d’achat, l’apparition de labels concurrents comme HVE (Haute Valeur Environnementale), des mentions imprécises de modes de production agricole (durable, intégrée, raisonnée, de précision…) ou « Sans résidus de pesticides », ou encore l’engouement pour les produits locaux, la crise post-Covid, la sous information, le coût et les questionnements. Toutes ces causes y ont contribué, mais la dernière est la moins étudiée, et, à notre avis, la plus importante. Elle a en tous cas été confirmée par plusieurs enquêtes.
Là encore, plusieurs causes :
Le « biobashing » se traduit de plusieurs manières :
Ainsi, la position prise par l’Académie d’Agriculture de France, société savante pluriséculaire, est à cet égard particulièrement lourde de conséquences. On peut lire, entre autres, dans sa Fiche n°12.01.Q01 « L’agriculture biologique en questions » de mai 2022 que « Les aliments bio ne présentent en général pas d’avantages, ni pour la nutrition ni pour la santé » et aussi que « Pour l’environnement, les conclusions sont plus mitigées, mais il apparaît que souvent le conventionnel fait aussi bien, ou mieux, que le bio ».
Des affirmations souvent infondées et contredites par de nombreuses publications scientifiques et des essais techniques, mais largement reprises telles quelles, sans vérifications, par des médias grand public de presse écrite ou radiotélévisée.
Pourquoi tant de défiance, de manque d’objectivité, de mauvaise foi et de mensonges ? Parce que l’AB contrarie de puissants intérêts économiques et l’idéologie productiviste des années post 1950. Sans doute, mais cela n’explique pas que des agronomes, enfermés dans des habitudes, mettent en doute l’intérêt de l’agriculture biologique. Certes, les nombreuses publications scientifiques concluant à ses effets bénéfiques, aussi bien pour la santé que pour l’environnement, ne constituent que des « preuves partielles selon les critères de la recherche scientifique » et les « biosceptiques » ont beau jeu de dire qu’il faut davantage de recherche alors qu’ils ne l’on jamais demandé ni soutenue depuis des décennies. On retrouve ici la stratégie du doute, largement utilisée dans d’autres controverses scientifiques, comme celle de la nocivité du tabac et de l’amiante ou de la réalité du réchauffement climatique. Ce qui n’empêche pas la Cour des Comptes, dans un important rapport publié récemment, de dire, en parlant de l’agriculture biologique, que « la littérature scientifique reconnait ses bénéfices sanitaires et environnementaux », et qu’elle devrait être davantage soutenue par les pouvoirs publics (Cour des Comptes, 2022).
Il y a par ailleurs quelque chose de plus insidieux, et propre à l’agriculture, à savoir la glorification du rendement. Face à l’augmentation de la population mondiale, il faut produire davantage, entend-on dire sans cesse. Alors que la production végétale actuelle suffit pour tous nous nourrir, avec 30 % de pertes et gaspillages, et aussi des milliards de trop pauvres, une nature dévastée, des rendements supérieurs en agroécologie/bio dans les pays pauvres, des scenarios de transition à la bio qui fonctionnent (Mueller, 2017). En conséquence, le critère retenu pour mesurer les effets d’un mode de production agricole sur l’environnement est généralement l’impact par kilogramme produit (approche financière) et non par hectare (approche environnementale et territoriale).
Ce qui a priori peut sembler logique, mais conduit à des aberrations en raison d’un biais méthodologique, à savoir qu’une production intensive, à base de pesticides et d’engrais azotés de synthèse, aura souvent, selon cette approche, un impact sur l’environnement par kilogramme produit apparemment inférieur à celui d’une production extensive moins productive, mais moins dépendante des intrants chimiques. Globalement, les cultures biologiques consomment, comparées à la production conventionnelle, moins d’énergie : -40 % (300/499) sur la base EQF (Équivalent Litres Fioul par hectare) et –11 % (91/102) par tonne de matière sèche produite. L’AB émet également moins de GES (gaz à effet de serre) que l’agriculture conventionnelle : en grandes cultures 1,46 contre 3,66 Teq1 CO2/ha de SAU et 0,444 contre 0,744 TeqCO2/t MS produite, grâce à l’absence des intrants chimiques pesticides et engrais de synthèse et à la préservation des sols (Bochu et al. 2008).
Produire plus paraît un objectif prioritaire face au problème de la sous-alimentation, mais c’est souvent une illusion si la consommation des intrants et d’énergie augmente plus que proportionnellement au surplus de rendement escompté. C’est évidemment une priorité dans les parties du monde où la production est insuffisante pour nourrir correctement la population, mais dans les pays riches, cela a des effets pervers. Par exemple, en France, les rendements en céréales ont été multipliés par quatre au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Jusque-là, les céréales servaient principalement à l’alimentation humaine. Aujourd’hui, 80% vont à l’alimentation animale, conduisant à l’industrialisation de l’élevage et au maintien de la consommation élevée de viande, aux effets néfastes pour la santé et l’environnement. Les céréales sont des objets de spéculations depuis des décennies et les matières premières agricoles se sont banalisées en tant qu’objets de marché. De même, l’augmentation des rendements des céréales en Chine a permis de multiplier par trois la consommation de viande de porc, sans pour autant rendre ce pays autosuffisant. On objectera qu’une partie des augmentations de production de céréales dans les pays industrialisés approvisionne les pays déficitaires en ces aliments de base, dont ils sont devenus dépendants.
Conclure que plus le rendement est élevé, plus l’impact environnemental par kilogramme est faible est sans doute comptablement vrai, mais faux si l’on tient compte de la totalité des impacts négatifs non comptabilisés. Une telle affirmation fait volontairement l’impasse sur les multiples coûts cachés de l’agriculture conventionnelle, qui ne se retrouvent jamais dans le prix payé au producteur et dans le prix de détail payé par le consommateur. Ces coûts très importants, parfois difficiles à établir – dépollutions multiples (sols, air, eaux), contaminations des milieux naturels et pertes de biodiversité, prise en charge des maladies liées aux pesticides…, font l’objet de débats sur leur évaluation. Ceux disponibles et sérieux, bien que sous-évalués, montrent que le vrai coût de l’alimentation pour la société (les citoyens donc) est deux à trois fois plus élevé que le coût d’achat. Ils sont payés de toutes façons in fine de façon indirecte par les citoyens, à travers les impôts et cotisations sociales.
L’inaptitude des évaluations habituelles à mesurer les effets d’un mode de production agricole sur l’environnement est aggravée par la méthodologie utilisée, celle notamment des ACV (Analyse du Cycle de Vie), mise au point et cohérente pour des produits industriels (pour lesquels elle a été conçue), mais inadaptée aux produits agricoles et alimentaires. En effet, elle ne prend pas en compte des critères essentiels, comme les impacts sur la biodiversité, les pollutions de l’eau et de l’air par les pesticides, la fertilité des sols cultivés, la séquestration du carbone…
Des études mettent en avant le fait que selon la méthode ACV, l’impact calculé de l’AB sur l’environnement par kilogramme produit est supérieur à celui de l’agriculture conventionnelle.
Le résultat est, par exemple, qu’une pomme conventionnelle, le fruit le plus consommé en France, ayant reçu 35 traitements chimiques par an en IFT2 : Indice de Fréquence de Traitement phytosanitaire, (soit la moyenne en France avec 22 fongicides, 9 insecticides, 2 herbicides et 2 régulateurs de croissance) sera jugée meilleure pour l’environnement qu’une pomme bio simplement parce que le rendement est supérieur. Ce n’est évidemment pas le cas lorsque toutes les externalités négatives sur l’environnement des rendements des productions conventionnelles sont intégrées dans le calcul, qui montre in fine que les produits biologiques ont nettement moins d’impacts négatifs que les produits conventionnels.
1) TEQ : tonne équivalent
2) L’IFT comptabilise le nombre de doses de référence utilisées par hectare au cours d’une campagne culturale. Cet indicateur peut être calculé par parcelle, par exploitation ou par territoire. Il peut également être décliné par grandes catégorie de pesticides (herbicides, fongicides, insecticides, acaricides ou autres produits).




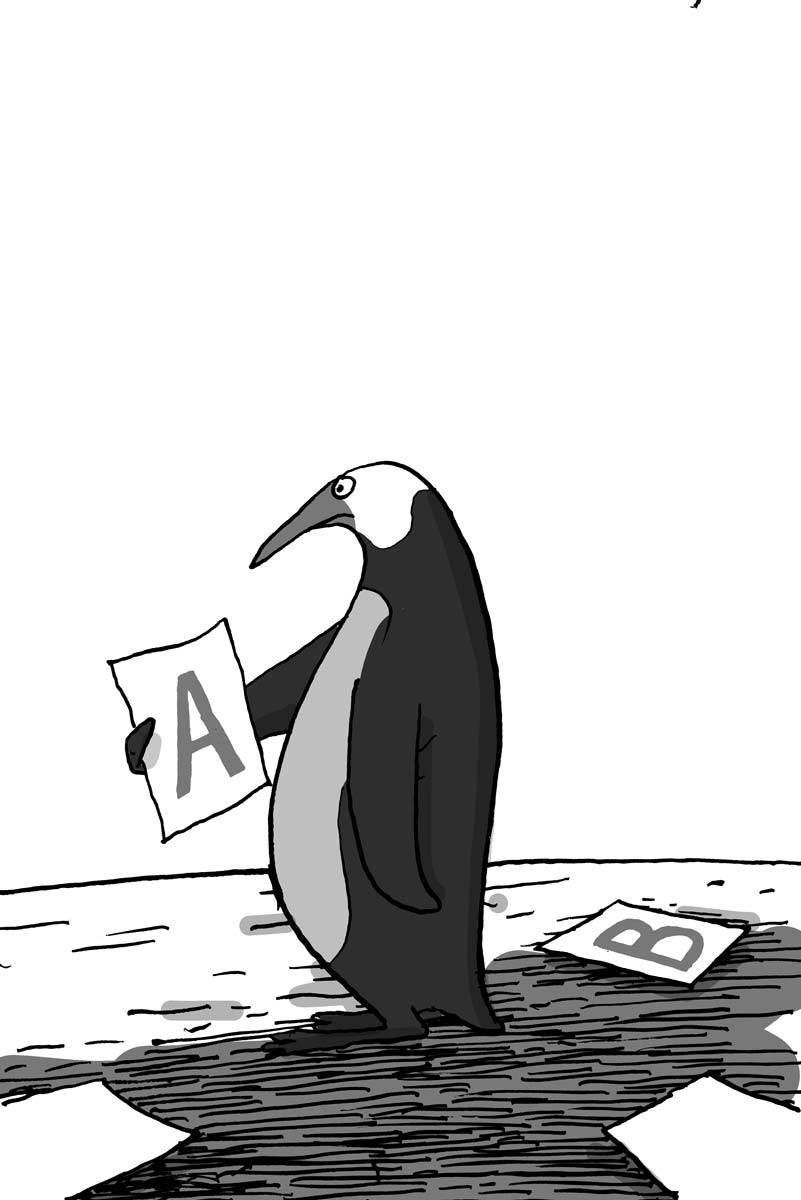
Les infos essentielles du marché bio spécialisé et des EAP, pour tout savoir sur l’actualité des marques, des distributeurs…
Les CGV sont disponibles sur simple demande merci d’utiliser notre formulaire pour nous les demander.
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.